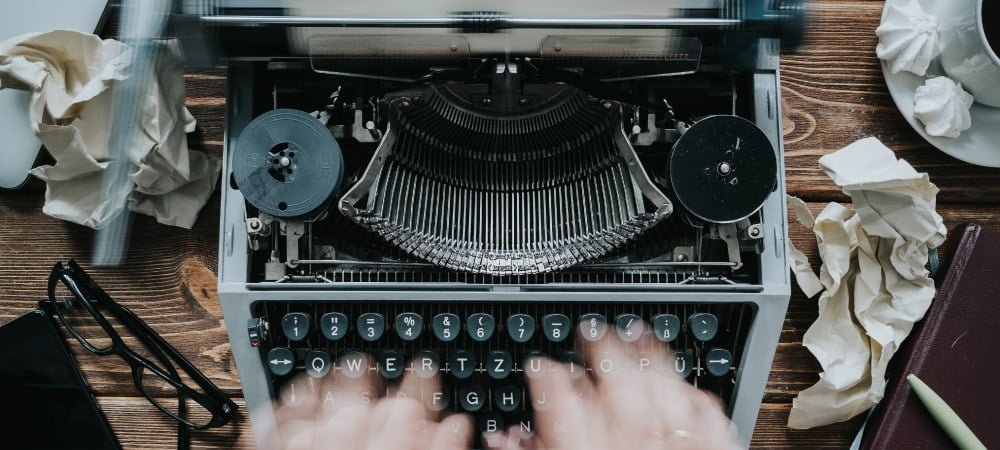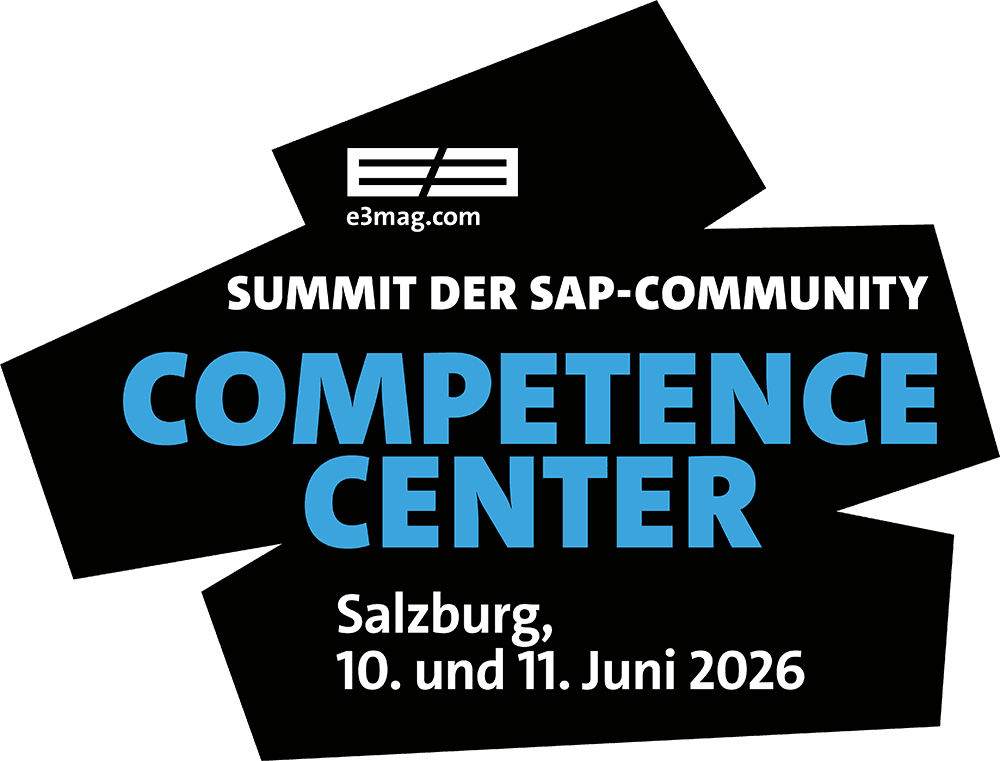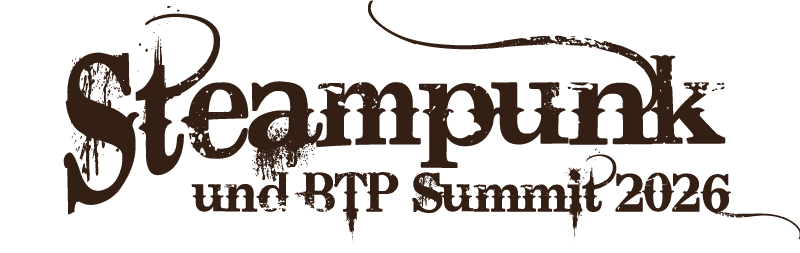L'esprit d'équipe bat l'algorithme


Les détaillants qui réussissent se distinguent avant tout par une stratégie élaborée, une planification minutieuse et une mise en œuvre ponctuelle. Qu'ils envisagent un réseau de chaîne d'approvisionnement nearshore plutôt qu'offshore pour le commerce de détail : Ils sont capables d'équilibrer les avantages et les risques de manière à prendre les bonnes décisions.
Potentiel de la chaîne d'approvisionnement
Dans les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail, une interaction parfaite est une priorité absolue. Les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail ne peuvent exploiter pleinement leur potentiel que si elles alignent toutes les fonctions sur un objectif commun. Lorsqu'un détaillant achète de nouveaux produits, il le fait en étroite collaboration avec la planification des ventes, l'exécution des commandes et la gestion des commandes. Si la planification, les opérations, la logistique, l'entrepôt et l'informatique se préoccupent exclusivement de leurs propres indicateurs clés de performance (KPI) internes, cela limite considérablement la collaboration interfonctionnelle et entraîne, outre des lacunes en matière d'information, une charge de travail beaucoup plus importante.
Le commerce de détail ne se résume pas à des étagères bien remplies. Les chaînes d'approvisionnement modernes du commerce de détail disposent d'un réseau immense de fournisseurs, de prestataires logistiques ainsi que de centaines ou de milliers de héros discrets qui font un travail précieux dans l'entrepôt, le transport et les magasins. Ils sont tous les véritables héros de la chaîne logistique. Rainer Schulz, directeur de Sysmat, explique quelles sont les étapes à franchir pour optimiser le flux de marchandises au sein de l'entreprise : "De plus en plus de facteurs d'influence agissent sur le quotidien des entreprises de tous les secteurs - et ne le facilitent pas vraiment. Les responsables sont donc constamment confrontés à la tâche d'examiner de près les choses qu'ils ont eux-mêmes en main et de les adapter si nécessaire. Le flux de matières au sein de l'entreprise en fait sans aucun doute partie. Son optimisation contribue entre autres à la réduction des coûts de production, des temps de passage et à l'amélioration de la qualité générale des produits. Pour aménager les processus en conséquence, différentes étapes sont nécessaires à la réussite de leur mise en œuvre".
Analyse et documentation
Il s'agit tout d'abord de se faire une idée de la situation actuelle. Pour ce faire, une analyse complète de l'ensemble des processus internes s'impose. C'est la seule façon pour les responsables de se faire une idée de toutes les positions pertinentes et d'inclure tout ce qui est nécessaire dans l'évaluation. Une documentation minutieuse joue un rôle décisif pour créer une base solide pour les étapes à venir. La visualisation de tous les processus permet aux entreprises de mettre en œuvre cette première phase de manière ciblée.
Grâce à l'analyse détaillée, on dispose désormais d'une base pour cette deuxième étape. Outre les éventuels goulots d'étranglement dans le stock, les responsables identifient les éventuels points faibles dans les processus - ou plus précisément les sources d'erreur possibles qui bloquent le flux de matériel. En effet, un manque d'organisation peut entraîner le dépassement des délais de livraison et le retard de l'arrivée des marchandises à destination ou chez le client. Pour identifier ces causes, une grande transparence est nécessaire.
Gestion des coûts
De nombreux responsables sont souvent réticents à moderniser leur entreprise, car ils craignent que cela n'entraîne l'arrêt de la production en cours. Les coûts représentent également un obstacle récurrent. Pourtant, l'actualisation permet de réduire les dépenses en veillant à ce que la chaîne d'approvisionnement soit exploitée au maximum. Dans le cas d'un ordinateur graphique de flux de matières, la situation est de toute façon différente : Il s'agit ici de maintenir les coûts à un niveau bas dès l'introduction. Des interfaces flexibles combinées à des fonctions de test étendues permettent de gagner jusqu'à 70 pour cent de temps lors de l'implémentation - ce qui se répercute positivement sur la facture. Au final, une période de mise en service de trois week-ends suffit, pendant que les responsables du projet examinent de près l'interaction de tous les systèmes. Ce n'est qu'après des tests réussis que le nouvel environnement fonctionne définitivement, il n'y a pas de perte de production.