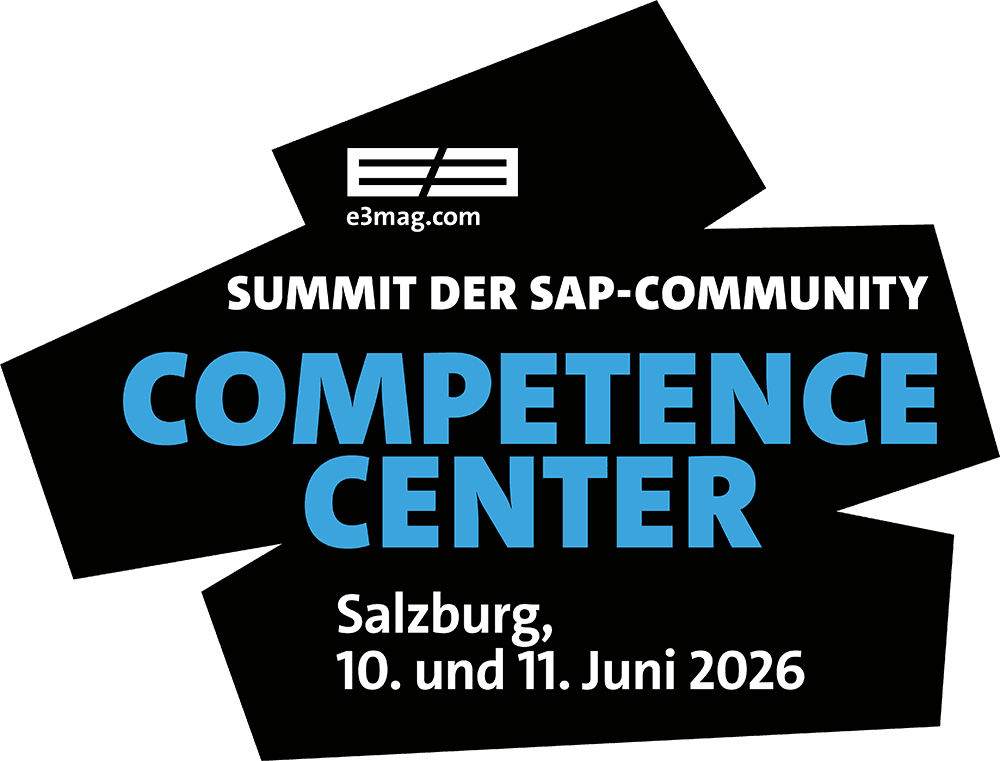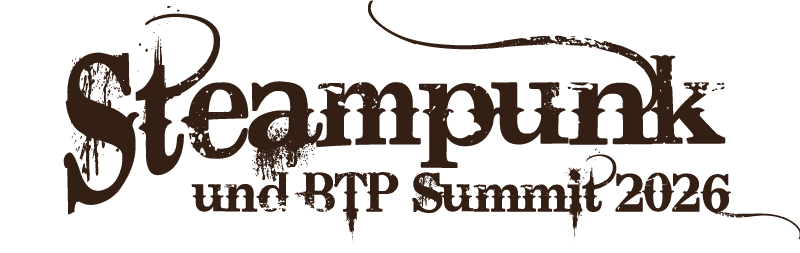Impôt sur les données ou taxe sur la valeur ajoutée ?


Les citoyens et les entreprises doivent se demander quelle est la valeur des données et qui les exploite. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE se penche sur la deuxième partie de la question.
Ainsi, les mêmes règles s'appliquent à tous ceux qui souhaitent monétiser des données via des produits et services personnalisés. Le prix à payer avec leurs données pour une offre parfaitement adaptée à leurs besoins peut être refusé par les citoyens de l'UE.
Le RGPD garantit le droit des citoyens et réglemente la concurrence. Celui-ci consiste à générer des idées à partir des données. Les données développent ainsi une valeur.
Il reste toutefois difficile de déterminer cette valeur. Au début d'un projet, certaines entreprises inscrivent les données au bilan comme valeur des fonds propres. Cela devrait conforter les partisans d'une taxe sur les données.
Toutefois, la valeur initiale reflète plutôt l'attente d'une création de valeur. Tant qu'il n'est pas possible de déterminer une valeur initiale précise, une taxe sur les données reste arbitraire.
Les informations importantes n'apparaissent souvent que lorsque les données sont évaluées, combinées avec d'autres et analysées à nouveau. C'est donc l'exploitation des données qui est déterminante.
Dans ce contexte, la justice et la solidarité doivent continuer à caractériser notre société civile. La tentative de l'UE de modifier l'impôt sur les sociétés de manière à ce qu'Amazon, Google, Facebook & Co. soient imposés sur leurs bénéfices là où ils les génèrent va dans ce sens.
La deuxième initiative de l'UE s'appelle "Digital Service Tax" et vise à taxer le chiffre d'affaires numérique. Aucun accord ne se dessine encore pour ces deux initiatives de l'UE.
Il reste donc l'occasion de tenir compte d'un fait essentiel dans la recherche de compromis : le monde physique et le monde virtuel s'estompent, ce qui entraîne un déplacement de la création de valeur - même au sein d'une entreprise.
À l'avenir, un constructeur de machines paiera-t-il plus ou moins d'impôts pour ses machines que pour ses services numériques, par exemple la maintenance prédictive ?
Il s'agira à l'avenir de taxer équitablement l'ensemble de la création de valeur, quel que soit le modèle économique utilisé. L'égalité des chances dans un autre sens pourrait en outre être instaurée par une obligation progressive de partage des données, comme l'a évoqué Viktor Mayer-Schönberger, professeur à l'Oxford Internet Institute.
Celui qui a atteint un certain pouvoir sur le marché devrait donc partager une partie de ses données avec la concurrence. La résistance serait ici programmée, un argument porteur : les investissements dans l'infrastructure informatique et la technologie qui permettent de collecter et d'analyser des données doivent être imposés, mais ne doivent pas être pénalisés - comme ce serait le cas avec le prétendu devoir de solidarité pour le partage des données.
En effet, aux coûts d'investissement et d'exploitation s'ajoutent les dépenses liées par exemple à l'emploi de data scientists qui rendent les données utilisables - c'est-à-dire monétisables. Les données ne sont donc pas gratuites pour les entreprises, même si les utilisateurs les fournissent volontiers.
Cet aspect devrait être pris en compte par les scientifiques. C'est à eux que la chancelière a demandé d'élaborer une taxe sur les données. Il reste à espérer que les scientifiques pensent à une "solution globale" pour transposer un modèle fiscal dans le monde numérique. Une réglementation européenne ne suffit pas.